Les Oulémas algériens et la Révolution : Clarifications à propos de certaines vérités historiques Taleb El-Ibrahimi répond à Belaïd Abdesselam
(Qoran, XLIX-6)
En 1989, alors que d’anciens responsables du FLN se concertaient périodiquement en vue d’adopter une position commune face à la crise politique née des évènements d’octobre 88 et prévenir le risque d’une guerre civile, M. Belaïd Abdesselam, «ancien» lui aussi, publiait un pamphlet où il me prenait à partie avec une rare agressivité. Le faisait-il par simple animosité personnelle ou pour complaire aux «décideurs» de l’époque qui redoutaient ma candidature éventuelle à la présidence de la République ? Ma ligne de conduite face à de telles situations a toujours consisté à ne jamais critiquer publiquement un compagnon de route. En l’occurrence, le compagnon de route, avec une hargne féroce, n’hésitait pas à me mettre en cause injustement. Je me préparais à user de mon droit de réponse à travers une émission lancée par la Chaîne III de la Radio nationale, lorsqu’un ami commun, arguant de considérants moraux, m’avait convaincu qu’entre anciens compagnons, une telle réaction s’apparenterait à une polémique stérile et non pas à un débat d’idées de haute facture.
Aujourd’hui, Abdesselam revient à la charge par la publication d’un libelle qu’il dédie, pour l’essentiel, à une attaque en coupe réglée contre le président des Oulémas, Cheikh Bachir El-Ibrahimi, mon père, et contre ma propre personne. Pourquoi cet acharnement alors que j’ai déclaré publiquement, il y a une dizaine d’années, que je quittais la scène politique active et Dieu sait que je ne suis pas l’homme des palinodies.
Nonobstant tous ces développements, l’occasion m’est offerte de rétablir la vérité sur certains faits historiques concernant Bachir El-Ibrahimi. Le jour de sa mort, le 20 mai 1965, c’est peut-être Houari Boumediène qui a le mieux résumé la vie et l’œuvre de l’homme en déclarant : «La disparition de Bachir El-Ibrahimi est une perte non seulement pour la famille qui a perdu un être cher mais aussi pour l’Algérie qui a perdu un éminent érudit et un grand combattant, et enfin pour le monde arabe et musulman qui a perdu un homme qui a œuvré toute sa vie pour la gloire de son pays, de l’Islam et de la langue arabe.»
Bachir El-Ibrahimi, qui appartient donc au peuple algérien, est issu d’une famille qui, tout au long du XIXe siècle, a vécu de l’agriculture et a vécu pour l’enseignement de la langue arabe et de l’Islam authentique. Après l’insurrection d’El-Mokrani, elle a été dépossédée de ses terres sans pour autant abandonner la formation d’étudiants. Cela a duré jusqu’au début du XXe siècle. En 1907, mon grand-père, Saadi El-Ibrahimi, comme beaucoup d’Algériens fuyant le Code de l’indigénat, émigra à Médine, à proximité du tombeau du Prophète. Bachir rejoignit son père en 1911 : il se consacra d’abord à l’acquisition du savoir le plus large possible puis entreprit, aussitôt après, de le transmettre. En 1917, il fut nommé professeur de littérature arabe dans le premier lycée moderne de Damas et beaucoup de ses élèves vont s’illustrer dans le monde de la culture et de la politique.
La seconde raison qui me pousse à rétablir certaines vérités historiques, c’est que le libelle est destiné à des lecteurs francophones qui n’ont, malheureusement, pas accès à l’œuvre de Bachir El-Ibrahimi. Car, en plus des 150 établissements d’enseignement qu’il a créés (avec l’argent du peuple algérien) sur l’ensemble du territoire national, il a laissé une œuvre dense qui s’étale sur plus de 35 ans, et qui n’est, hélas, disponible qu’en langue arabe.
Juger un homme sans avoir lu un seul texte de lui est une aberration. A moins de considérer – à l’instar de certains historiens français – qu’un document écrit en arabe n’est pas un document. Ce qui est une autre aberration.
En 1920, abandonnant une situation confortable, il décida de retourner au pays pour s’installer à Sétif où il créa une école primaire et une mosquée tout en s’associant à un compatriote du M’zab dans une épicerie pour subvenir aux besoins de la famille. Une école «libre» et une mosquée «libre», est-il besoin de le souligner, car elles ne dépendaient pas de l’administration coloniale. Celle-ci, contre toute attente, proposa à Bachir El-Ibrahimi un poste de mufti qu’il déclina. La famille ne comptait pas – et ne comptera pas – d’auxiliaire de l’administration coloniale, règle d’or à laquelle mon père veilla à ne jamais déroger. Pendant dix années, Bachir El-Ibrahimi, en compagnie de Abdelhamid Ben Badis, sillonnera les villes de tout l’Est algérien. Pour mémoire, lorsqu’ils arrivaient dans une ville ou un village, un indicateur de la police coloniale les attendait à la porte du car pour leur dire : «Messieurs, l’administrateur (Sidi el-Hakem) vous attend.» Ils se rendaient, alors, chez l’administrateur qui les interrogeait sur le but de leur visite. «Nous sommes venus prodiguer un cours d’exégèse coranique à la mosquée», répondaient-ils. Il leur faisait signer, alors, un document dactylographié où ils reconnaissaient ne pas s’immiscer dans les questions politiques en limitant leur discours aux strictes questions religieuses. C’est par ce travail de longue haleine qu’ils sont arrivés, néanmoins, à inculquer aux Algériens les fondements de leur identité.
En 1930, avec pompes et solennités, est intervenue la célébration, à Alger, du centenaire de l’occupation de l’Algérie en présence du président de la République française en personne, qui semblait vouloir signifier au monde entier que «sur cette terre désormais française, s’en est fini de l’Islam, de la langue arabe et de l’Algérie libre».
Ironie de l’histoire, ce fut, précisément, à partir de 1931 que le mouvement nationaliste algérien se confortât autour de deux pôles complémentaires, un pôle politique animé par le PPA présidé par Messali Hadj qui a incrusté le concept d’indépendance dans les consciences algériennes, et un pôle culturel, incarné par l’Association des Oulémas que présidait Abdelhamid Ben Badis et dont le souci principal portait sur le renforcement de l’identité algérienne. D’autres expressions du nationalisme algérien s’étaient manifestées mais dans l’Algérie profonde, le PPA et l’Association des Oulémas étaient les plus présents. Parmi les disciples de mon père à la médersa de Dar El-Hadith de Tlemcen, d’ailleurs, ceux qui avaient en poche leur carte d’adhésion au PPA sans y voir une contradiction. Plus tard, interrogeant l’un de ceux-ci sur la manière dont il vivait cette double appartenance, il me répondit avec sagacité : «Pour moi, il y avait complémentarité : Messali nous a appris vers où nous devions aller ; Bachir El-Ibrahimi nous a révélé d’où nous venions et ce que nous sommes.»
En 1933, l’Association des Oulémas musulmans algériens – créée, rappelons-le, en 1931— procéda à une répartition des tâches entre ses principaux dirigeants en fonction de la division administrative du pays à l’époque, trois départements français. Abdelhamid Ben Badis, installé à Constantine, prenait en charge l’est du pays ; Tayeb El-Okbi, fixé à Alger, avait la responsabilité du centre du pays. L’ouest algérien échut à Bachir El-Ibrahimi qui s’installa à Tlemcen. La ville de Tlemcen disposait, alors, d’une douzaine de mosquées, héritées de nos ancêtres depuis les Almoravides jusqu’aux Ottomans en passant par les Zianides. Ces mosquées auraient pu abriter l’enseignement de Bachir El-Ibrahimi mais elles furent interdites en vertu de la circulaire Michel (1) qui n’autorisait leur accès qu’aux seuls imams nommés et rémunérés par l’administration coloniale. Bachir El-Ibrahimi n’en fut pas moins à l’origine d’une véritable renaissance culturelle à Tlemcen couronnée par l’inauguration par Ben Badis de la célèbre médersa Dar El-Hadith en septembre 1937. Son enseignement dérangeait l’administration coloniale qui le suspendit à plusieurs reprises ; au total, la Medersa forma des milliers de disciples dont certains se firent remarquer dans l’Algérie indépendante, tels Tidjani Haddam, ministre de la Santé sous Boumediène, et Abdelmadjid Meziane, ministre de la Culture sous Chadli.
Le sous-préfet de Tlemcen, durant les années 30, dans ses rapports au Gouverneur général, qualifie à maintes reprises Cheikh El-Ibrahimi d’«ennemi numéro un de la France».
A la veille de la Seconde Guerre mondiale, Bachir El-Ibrahimi, sollicité par les autorités françaises pour participer à des émissions radiophoniques – la télévision n’existant pas encore – en faveur des alliés contre l’Allemagne, déclina l’invitation, soulignant que le peuple algérien n’était pas partie prenante à ce conflit. Le Gouvernement général avait dépêché auprès de Bachir El-Ibrahimi le cadi Benhoura muni, à la fois de la carotte – un poste de Cheikh El-Islam en Algérie – et du bâton – l’exil. Il fut, alors, arrêté le 10 avril 1940 et transféré dans un village du sud oranais, Aflou, où il fut astreint à trois années de résidence surveillée.
Bachir El-Ibrahimi prit part à l’expérience des «Amis du Manifeste et de la Liberté» tant il était obsédé par l’union des partis politiques algériens contre la France. Il fut l’artisan du rapprochement, sous la même bannière, de l’UDMA et du MTLD.
Dans le même esprit, il soutiendra dans les années cinquante le Front pour le respect des libertés démocratiques» qui regroupera, outre le MTLD et l’UDMA, les Oulémas et le Parti communiste algérien. C’est à ce titre que j’ai vu, adolescent, de nombreux dirigeants du PPA puis du MTLD se succéder au siège de l’Association des Oulémas pour se concerter avec Bachir El-Ibrahimi. Le docteur Lamine Debaghine, en particulier, rendait, régulièrement, visite à mon père au domicile familial. Je n’ai jamais assisté aux conciliabules qui s’y déroulaient, mais un jour, au seuil de la porte de sortie, Lamine Debaghine se tournant vers Bachir El-Ibrahimi, lui dit : «Nous travaillons pour les mêmes objectifs, avec sans doute des moyens différents. La seule chose qui nous sépare, c’est Messali et son narcissime.»
Au lendemain des événements du 8 Mai 1945, les autorités françaises décident la dissolution des AML et la fermeture des medersas de l’Association des Oulémas. Bachir El-Ibrahimi et Ferhat Abbas, accusés d’être les instigateurs des manifestations anti-françaises, sont incarcérés dans des conditions extrêmement dures pendant 10 mois, d’abord à la prison militaire d’Alger, puis à Constantine, et ne seront libérés qu’en mars 1946.
Bachir El-Ibrahimi fréquentait les Algériens les plus aisés ? En vérité, dans les foules qu’il rassembla des décennies durant, toutes les catégories du peuple algérien étaient présentes, y compris les personnes riches, mais pas exclusivement. Bachir El-Ibrahimi avait sollicité les couches aisées de la société algérienne pour les faire participer à la construction des 150 écoles érigées à travers tout le territoire national, également l’Institut Ben Badis, établissement secondaire de référence, créé à Constantine. Pour mémoire, l’Association des Oulémas ne bénéficiait, en effet, d’aucune subvention de l’administration coloniale qui, au contraire, combattait sans répit tous ses projets. C’est cette école de l’Association qui a immunisé les jeunes Algériens contre l’aliénation de l’enseignement colonialiste qui, bien que fenêtre sur la technologie et la modernité, visait l’assimilation.
A évoquer les biens de ce monde, retenons que Bachir El-Ibrahimi n’a légué à ses enfants ni hectares, ni dinars, ni dollars, pas même un toit familial. Le loyer de la modeste demeure où il s’éteignit était acquitté grâce à mon salaire de médecin à l’hôpital Mustapha. En revanche, il a laissé un nom révéré dont la famille s’honore. Dans les années quarante, Bachir El-Ibrahimi prit l’initiative de réunir les grands commerçants algériens auxquels il tint le langage suivant : «Le colonialisme s’est appuyé sur trois forces pour nous dominer : les militaires, les marchands et les missionnaires, les 3 M. Les missionnaires, l’Association des Oulémas se charge de les combattre en diffusant la langue arabe et l’Islam authentique. Occupez-vous des marchands, en créant une société qui se chargerait, en même temps que de développer la production nationale, d’importer directement les besoins des Algériens à partir de l’étranger, sans passer par les intermédiaires français. Quant aux militaires, bientôt, si Dieu le veut, l’Algérie aura parmi ses enfants des hommes qui sauront les affronter sur le terrain.» C’est ainsi que fut créée la société Amel dont l’histoire reste à écrire.
Cette évocation annonciatrice du 1er Novembre 1954 se complète avec la déclaration de Bachir El-Ibrahimi devant les délégués arabes et musulmans à l’ONU, réunis à Paris le 29 janvier 1952. Après avoir appelé à l’union des Maghrébins, des Arabes et des musulmans pour sortir de la décadence et se libérer de la dépendance, il déclara, en effet, qu’«en Algérie, au temps des discours succédera bientôt le temps des armes»(2).
Pour appréhender le cours effectif de l’histoire du mouvement national algérien jusqu’au déclenchement de la guerre de Libération nationale, il importe de mettre en exergue la conjonction d’efforts entre tous les partis gagnés à l’idée nationale.
Les six dirigeants ayant déclenché la révolution furent, rapidement, convaincus de la nécessité du plus large rassemblement pour garder à la révolution sa vigueur et sa constance et lui donner le plus large retentissement. Emprisonné en France depuis des années, Abane Ramdane, libéré en février 1955, débarqua à Alger et prit place, rapidement, comme coordonnateur de fait de la Révolution.
Pour ces fondateurs, le FLN devait, comme son nom l’indique, constituer un front ouvert à tous ceux qui croyaient que le 1er Novembre est une date discriminante, le temps des discours ayant cédé la place au temps des armes. Leur devise était « Rassembler et non exclure». Pour ces dirigeants, le courant ennemi à la révolution était représenté par le MNA contre lequel tous les efforts étaient concentrés. La stratégie adoptée pour assurer la suprématie du FLN, tant dans les maquis qu’au sein de la population, fut couronnée de succès. Pour preuve, le général de Gaulle, après sept années de guerre, sera bien acculé à reconnaître l’indépendance de l’Algérie et à négocier, exclusivement, avec le FLN, après avoir espéré, jusqu’à la dernière minute, faire participer à la table des négociations «une troisième force» représentée, en particulier, par le MNA que d’aucuns voudraient réhabiliter.
Cette hostilité à l’égard de l’Association était absente à l’époque des dirigeants historiques du FLN. Mostefa Ben Boulaïd et Larbi Ben M’hidi, pour ne citer que ceux-là, avaient de solides accointances avec les Oulémas à travers l’enseignement dispensé ou les structures locales. Deux chefs de wilaya, les colonels Amirouche et Chaâbani, étaient oulémistes. Des dirigeants connus de l’Association des Oulémas sont tombés sous les balles de l’OAS ou des services français comme le publiciste Lamine Lamoudi, le théologien Larbi Tébessi, le romancier Redha Houhou et le poète Rabei Bouchama. Parmi les premiers militants qui répondirent à l’appel du 1er Novembre, les étudiants de l’Institut Ben Badis n’étaient pas en reste, simples soldats ou officier, voire commissaires politiques de l’ALN. Des milliers d’adhérents ou de cadres de l’Association vécurent des années durant dans les prisons et camps d’internement coloniaux. D’autres responsables de l’Association, en raison de leur âge et de leur notoriété, ont été représentants du FLN (voire du GPRA) dans différentes capitales arabes.
Témoignant de cet esprit prônant le rassemblement au sein du FLN, Ferhat Abbas raconte qu’ayant rendez-vous avec Abane Ramdane en 1956, il le trouva en compagnie de quatre personnes, apparemment des agents de liaison leur tenant ce langage en guise d’adieu : «Vous étiez hier des disciples de Ferhat Abbas, de Messali Hadj ou de Bachir El-Ibrahimi. Désormais, vous êtes des militants du FLN.» Le même jour, Abane Ramdane, à l’issue de l’entretien qu’il eut avec Ferhat Abbas, s’adressa à lui ainsi : «Lorsque j’avais vingt ans, mes responsables m’avaient appris à t’insulter. Je l’ai fait à maintes reprises. Aujourd’hui que je te connais et que je vois où se trouve Messali Hadj, je te présente mes excuses.» Qu’en est-il de la réaction de Bachir El-Ibrahimi à la révolution algérienne ?
Le 1er Novembre 1954, Bachir El-Ibrahimi se trouvait au Caire à l’invitation de plusieurs ministres des Affaires étrangères des pays arabes et musulmans qui l’avaient invité lors de la rencontre tenue à Paris en 1952 sous l’égide de l’ONU. La raison affichée consistait à obtenir l’équivalence des diplômes de l’Institut Ben Badis avec le baccalauréat de leurs pays. Mais la raison véritable consistait, cependant, à servir la cause algérienne.
Des cinq tomes qui constituent l’œuvre de Bachir El-Ibrahimi, le cinquième tome contient tous les écrits consacrés à la révolution. Dès le 15 novembre 1954, Bachir El-Ibrahimi publiait un «appel au peuple algérien» l’exhortant à soutenir le soulèvement qui venait de se produire. Cet appel revêtait le caractère d’une véritable fetwa pour le peuple algérien car il émanait de la plus haute autorité spirituelle de l’Algérie musulmane. Pour s’assurer que son message parviendrait au peuple algérien, Bachir El-Ibrahimi confirma son appel par huit causeries diffusées par la radio Sawt el-Arab d’avril à juin 1955, dont les thèmes commencent par «accepter le colonialisme, c’est renier l’Islam» jusqu’à «les lois de la guerre en Islam»(3).
Après avoir envoyé un télégramme au président égyptien Djamel Abdennasser pour le remercier de son soutien au déclenchement de la Révolution(4), Bachir El-Ibrahimi adressa un autre télégramme, le 9 janvier 1955, au roi saoudien Saoud ben Abdelaziz Al Saoud le sollicitant pour désigner Abderrahmane Azzam, ancien secrétaire général de la Ligue arabe, ou Ahmed Choukeyri, membre de la délégation saoudienne à l’ONU, pour se consacrer exclusivement à la défense de la cause algérienne, en collaboration avec les délégués du FLN à New York. Ahmed Choukeyri fut choisi à cette fin et ses discours enflammés sur la Révolution algérienne restent dans bien des mémoires(5).
Les autorités françaises s’intéressaient aux activités de Bachir El-Ibrahimi au Caire. Un document du SDECE, daté du 18 décembre 1954, révèle qu’un commando de jeunes Algériens, pour la plupart étudiants d’El-Azhar, se préparaient au Caire, sous la conduite d’officiers égyptiens, à la guérilla, en particulier le maniement des explosifs. Le document indique que le 29 novembre 1954, les membres de ce groupe furent reçus par Mohamed Khider, membre de la délégation extérieure du FLN, qui les conduisit chez Bachir El-Ibrahimi en vue de parfaire leur formation idéologique. Les services français identifient cinq des membres de ce commando parmi lesquels Mohammed Boukharrouba, le futur Houari Boumediène.
En février 1955 se déroula au Caire une réunion du «Front pour la libération de l’Algérie» regroupant les leaders politiques algériens présents dans la capitale égyptienne avec pour objectif de soutenir le FLN. Cette réunion regroupait :
– deux messalistes : Ahmed Mezghena et Chadli Mekki ;
– deux centralistes : Hocine Lahouel et M’hammed Yazid ;
– un udmiste : Ahmed Bayoudh ;
– deux oulémistes : Bachir El-Ibrahimi et Fodil El-Ouertilani ;
– trois frontistes : Mohamed Khider, Ahmed Ben Bella et Hocine Aït-Ahmed(6).
Ce furent, paradoxalement, les deux messalistes qui insistèrent auprès de Bachir El-Ibrahimi pour cette réunion, dans le souci de ne pas rester hors course après que Messali eut décidé de se démarquer du FLN.
En juin 1955, Bachir El-Ibrahimi donna à l’Institut des hautes études arabes du Caire une série de conférences sur le colonialisme français en Algérie. Puis en novembre 1955, il publia dans la revue libanaise Al-Irfane un article consacré au premier anniversaire de la révolution algérienne(7).
En 1956, cependant, les relations de Bachir El-Ibrahimi avec les autorités égyptiennes se détériorèrent. Il dut quitter Le Caire, n’acceptant pas la mainmise des services de renseignement égyptiens — «Moukhabarate» — sur une partie de la délégation extérieure du FLN, plus précisément sur Ahmed Ben Bella. N’était sa notoriété dans le monde musulman, Bachir El-Ibrahimi aurait subi le sort des deux représentants de Messali Hadj, Ahmed Mezghana et Chadli Mekki, qui croupirent dans les geôles égyptiennes durant quelques années.
Entre mars 1956 et août 1957, Bachir El-Ibrahimi vécut entre le Pakistan, la Syrie, l’Arabie Saoudite, le Koweït et l’Irak. C’est en Irak qu’il prononça, en avril 1957, à l’occasion de la semaine de l’Algérie, une conférence sur la «Révolution algérienne», conférence dont la conclusion était éloquente : «Nous pouvons dire, sans exagération ni parti-pris, que la Révolution algérienne est un chapitre unique dans l’histoire de l’humanité qui a été lu avant d’être écrit et compris, avant d’être conclu. Et le jour où il sera écrit, il constituera un tome original dans l’histoire des révolutions libératrices.» C’est à travers Radio Tétouan, au Maroc, en mai 1957, que Bachir El-Ibrahimi put transmettre cette allocution au peuple algérien selon la présentation qui en avait été faite par les animateurs de ladite radio : «Nous sommes heureux de vous faire entendre cette allocution improvisée par le grand érudit Bachir El-Ibrahimi, au nom du FLN, au cours des cérémonies organisées à Bagdad à l’occasion de l’ouverture de la semaine de l’Algérie.» (8)
Pour rappel, c’est le CCE (Comité de coordination et d’exécution) qui intervint au Caire auprès de Djamel Abdennasser pour que Bachir El-Ibrahimi puisse revenir au Caire sans faire l’objet de harcèlement de la part des services de renseignement égyptiens. Il put, en effet, revenir de nouveau au Caire et s’y installer jusqu’à l’indépendance de l’Algérie en juillet 1962.
Au nombre de ses activités, Bachir El-Ibrahimi était toujours la personnalité qui prenait la parole pour apporter le témoignage de reconnaissance de la révolution algérienne lors des différentes manifestations de sympathie et de soutien qui étaient organisées au profit de l’Algérie combattante. Ainsi, c’est lui qui, le 1er novembre 1957, prend la parole à la Radio du Caire à l’occasion du 3e anniversaire de la révolution algérienne.
En mars 1958, pareillement, de grands noms de la littérature égyptienne se réunissaient au Caire, en présence de Bachir El-Ibrahimi, dans une manifestation de solidarité avec l’Algérie combattante. Des musulmans et des chrétiens, des croyants et des agnostiques étaient présents à l’instar de Youcef Sibâai, futur ministre de la Culture, Taha Hussein, Louis Awad, Ahmed Bahaâ Eddine, Salama Moussa, Anwar Abdelmalek, Raja Nakkache, Youcef Idriss, Alfred Faradj, Mohamed Amine Al-Alaam(9).
Le 13 juin 1958, Bachir El-Ibrahimi adressa une lettre au mufti d’Arabie Saoudite, Mohamed Al Cheikh, par l’intermédiaire de la délégation officielle du FLN au pèlerinage, afin que ce dernier remette à ladite délégation les sommes collectées par les Saoudiens au profit de la révolution algérienne(10).
Au lendemain de la création du GPRA, dès septembre 1958, Bachir El-Ibrahimi eut à se manifester à la demande de ce dernier en de multiples occasions : pour la célébration du 4e anniversaire du 1er Novembre, à l’occasion des conférences tenues au siège des jeunesses musulmanes sur «L’Algérie révolutionnaire» en 1958 (11) et sur «Des pages glorieuses sur l’histoire des révolutions» en mars 1959(12). Bachir El-Ibrahimi était entouré de l’affection et du respect des membres du GPRA qui venaient lui rendre visite ou même le consulter. Le plus assidu d’entre eux était, sans doute, le ministre des Affaires étrangères, Krim Belkacem, lequel qui en partance en mission à l’étranger ou de retour s’arrêtait à Héliopolis pour entretenir Bachir El-Ibrahimi de l’objet de sa mission.
Dans l’attente d’un retour au pays qu’il espérait revoir avant sa mort, Bachir El-Ibrahimi se rendit à Tunis en juin 1961 où un comité algéro-tunisien organisa une cérémonie d’hommage à son honneur. Cette cérémonie se déroula le 13 juillet 1961 avec la participation, entre autres, de l’éminent théologien tunisien Fadhel Ben Achour et du grand poète algérien Moufdi Zakaria. Dans son allocation, Bachir El-Ibrahimi souligna bien que l’hommage revenait «à l’Algérie, sa révolution, ses martyrs et ses prisonniers»(13).
Le 12 mars 1962, Bachir El-Ibrahimi est reçu officiellement à l’Académie de langue arabe au Caire et c’est lui qui fut désigné pour parler au nom des 11 récipiendaires.
A la veille de l’indépendance, la joie de Bachir El-Ibrahimi est entachée par la lutte pour le pouvoir qui se déroulait à Tripoli au sein des instances du FLN. En juin 1962, Djamel Abdennasser dépêcha deux émissaires auprès de Bachir El-Ibrahimi lui proposant de mettre à sa disposition un avion spécial qui le mènerait à Rabat d’où il rejoindrait Oujda puis Tlemcen en compagnie de Ahmed Ben Bella afin d’assurer à celui-ci un accueil triomphal par le peuple algérien. Bachir El-Ibrahimi rejeta la proposition en soulignant : «Tous les dirigeants du FLN sont mes enfants, je me garderais bien de prendre position pour les uns contre les autres. Mon rôle a consisté et consistera à les unir pour éviter que des divergences ne débouchent sur une scission.» (14) Probablement, cette prise de position s’ajoutant aux différends antérieurs déplut à Ahmed Ben Bella qui, devenu président de la République, manifesta une hostilité tenace à l’encontre de Bachir El-Ibrahimi. Pourtant, les Algériens ayant décidé que la mosquée Ketchaoua, devenue cathédrale sous la colonisation, redevienne mosquée, le président Ahmed Ben Bella fut bien obligé de faire appel à Bachir El-Ibrahimi, le jour de l’inauguration, pour diriger la prière du vendredi 2 novembre 1962 en présence de nombreuses personnalités étrangères dont le roi du Maroc Hassan II(15).
Le cheikh Bachir El-Ibrahimi meurt le 20 mai 1965. La première personnalité à venir se recueillir devant sa dépouille en son domicile fut Houari Boumediène, alors vice-président du Conseil et ministre de la Défense nationale.
Le lendemain, 21 mai 1965, jour des obsèques, le directeur de la Radio et de la Télévision algérienne (RTA), encouragé certes par Chérif Belkacem, alors ministre de l’Orientation nationale, fit preuve d’un courage incroyable en décidant de couvrir les funérailles par la télévision non sans avoir interrompu, la veille, les émissions de la radio en les remplaçant par la psalmodie de versets coraniques, en signe de deuil. Naturellement, il aura droit à une volée de bois vert de la part du Président Ben Bella.
De son côté, le quotidien officiel arabophone Echaâb fait preuve d’une audace non moins surprenante en publiant, dans son édition du 22 mai 1965, un article intitulé «Le peuple aux funérailles de l’Imam» qui mettait en exergue la symbiose d’idées entre le peuple et le défunt. Deux cent mille Algériens, chiffre officiel annoncé par la Radio nationale, suivirent la dépouille de Bachir El-Ibrahimi lui rendant l’hommage qu’il méritait. Plus tard, le président Houari Boumediène, dans une interview à la revue Al Hawadith, reconnaîtra que le spectacle des obsèques du cheikh Bachir El-Ibrahimi l’ont amené à précipiter la date de déposition de Ahmed Ben Bella. Au cimetière algérois de Sidi M’hamed, il y avait certes les compagnons de Boumediène, Chérif Belkacem, Abdelaziz Bouteflika et Ahmed Medeghri, mais également Benyoucef Benkhedda et Mohamed Saïd et beaucoup d’autres collègues de la faculté ou du corps médical ou d’anciens amis de l’Ugema. Ferhat Abbas, en résidence forcée à Adrar, notera dans ses mémoires : «C’est dans cette ville du sud que j’ai appris la mort du cheikh Bachir El-Ibrahimi, une grande figure de l’Islam disparaît. Cheikh Bachir El-Ibrahimi fut mon compagnon de cellule après mai 45 à la prison militaire de Constantine. Il fut aussi mon père spirituel.» Ainsi, le peuple algérien tout entier avec la quintessence de la classe politique du pays s’était associé au deuil de la famille de Bachir El-Ibrahimi. Les seuls absents étaient Ahmed Ben Bella et ses fidèles les plus proches.
Ces rappels interviennent alors que le peuple algérien célèbre le vingt-troisième anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954. Le souvenir des époques glorieuses contraste avec les temps difficiles d’aujourd’hui où les Algériens sont engagés dans une lutte de survie.
Nous traversons assurément des temps de troubles, que Victor Hugo a trouvé les justes mots pour les décrire : «Quand le soleil décline à l’horizon, le moindre caillou fait une grande ombre et se croit quelque chose.»
Mais l’inconsistance des cailloux ne pourra nous faire oublier la permanence des chaînes montagneuses, qui nous permettent d’accéder au savoir et à la vérité par d’innombrables versants, qui renferment les trésors du patrimoine ancestral et qui constituent des remparts sûrs contre l’ignorance et l’aliénation. Cheikh Bachir El-Ibrahimi est une de ces montagnes. Son parcours, en se mêlant au destin national, nous apporte un éclairage sur les étapes essentielles de l’histoire contemporaine de notre pays.
La France a commis en Algérie un véritable «génocide culturel». En effet, par la destruction du dispositif d’enseignement traditionnel, l’exclusion des Algériens du système d’enseignement moderne et le contrôle administratif du culte musulman, la conquête coloniale visait à déposséder les Algériens, outre de leurs terres et de leur souveraineté, de leur mémoire, de leur culture et de leur identité.
En un mot, il s’agissait de dévitaliser la société algérienne pour en faire une multitude d’individus apathiques et amorphes. C’est sur ce terrain fondamental que se situe le combat des Oulémas et leur courant de l’Islah, qui ne signifie pas «réforme», mais bien plutôt «réparation» et «restauration» avec les matériaux d’origine, la langue arabe et l’Islam pour que le peuple algérien retrouve sa dynamique sociale et soit capable de mouvement d’ensemble de reconquête de soi.
La finalité de l’Islah est donc la révolution, telle qu’elle a été définie par Pierre Rossi : «révolution», terme qui désigne sans doute, ici comme ailleurs, le désir d’un peuple de ne pas s’oublier, de remonter au contraire aux sources originelles dont il est issu. La conscience de ce qu’il fut amène [le pays] à s’engager dans une véritable reconquête de soi dont les phases, pour confuses qu’elles paraissent, ne doivent pas faire perdre de vue la lumière directrice.
L’action des Oulémas n’a pas perdu son exemplarité. Ils nous rappellent que c’est par l’éducation et seulement par l’éducation que nous parviendrons à relever nos défis.
Cheikh Bachir El-Ibrahimi a quitté ce monde avec l’apaisante satisfaction d’avoir accompli son devoir, guidé par sa foi et animé par ses liens d’attachement à son pays et son peuple.
T. E.I.
Notes
1) Le 16 février 1933, la circulaire Michel, du nom du secrétaire général de la préfecture d’Alger, Jules Michel, enjoignait les autorités coloniales de surveiller les Oulémas suspects «de chercher à atteindre la cause française». Cette circulaire Michel avait pour effet :
– L’interdiction des mosquées dites officielles aux prédicateurs réformistes.
– La surveillance des divers agents de la propagande réformiste.
Ces mesures se traduisirent par de nombreuses fermetures d’écoles coraniques.
2) Œuvres d’El-Ibrahimi, Tome 2, page 466.
3) Œuvres de Bachir El-Ibrahimi, Tome V, pp.58-94
4) Op. cité, p. 49
5) Op. cité, p.51
6) Œuvres de Bachir El-Ibrahimi, Tome V, p. 53
7) Op. cité, pp. 98-147
8) Op. cité, pp. 179-182
9) Œuvres de Bachir El-Ibrahimi, Tome V, pp. 216-220
10) Op. cité, p. 221
11) Op. cité, p. 236
12) Op. cité, p. 252
13) Op. cité, p. 268
14) Œuvres de Bachir El-Ibrahimi, Tome V, p. 303
15) Op.cité, p.305
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/11/08/article.php?sid=219575&cid=41

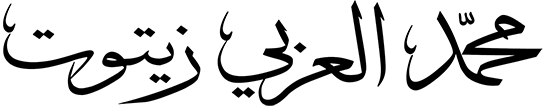


التعليقات مغلقة.